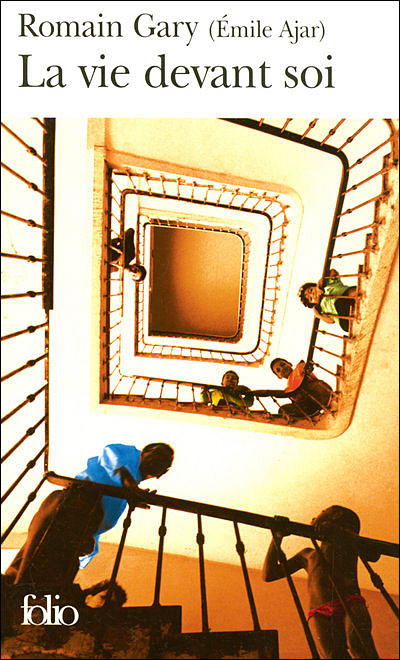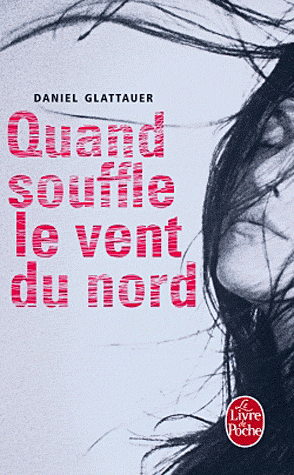« Dans ce monde médico-industriel, on élargit les limites des pathologies, on médicalise les évènements de la vie et nos émotions, on joue sur nos peurs en dramatisant les enjeux de la politique de santé et les risques de maladie pour nous pousser à consommer davantage de médicaments, on effectue des bilans de santé pour dépister la moindre anomalie, qui sera ensuite source d’examens complémentaires et de traitements supplémentaires, on fabrique des maladies pour créer des malades devenus des consommateurs de soins. »
Depuis quelques décennies, la célèbre formule du docteur Knock « Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore ! » semble être devenue le leitmotiv de l’industrie pharmaceutique et autre divers acteurs de la médecine.
Jamais la médicalisation n’avait occupé une place aussi importante et aussi vaste dans nos vies quotidiennes. Dans ce livre au titre choc, le docteur Sauveur Boukris nous montre comment le moindre mal est désormais systématiquement traduit en symptôme voir directement en maladie – chronique si possible ! -, pour devenir la cible d’un traitement médicamenteux. La tristesse prend le nom de dépression, la timidité se change en phobie sociale, l’anxiété en spasmophilie… « Toutes les difficultés de la vie quotidienne sont supposées aujourd’hui appeler une réponse médicale. (…) La médicalisation du mal-être et la psychiatrisation de l’existence sont devenues une réalité. »
Il note également comment la moindre douleur, le plus petit trouble devient prétexte à d’innombrables examens, nous transformant dès lors en malades potentiels. Des douleurs que l’on n’attend parfois même plus pour enclencher la machine médicale puisque de nombreuses pathologies se voient aujourd’hui anticipées par des campagnes de dépistage et autre bilans médicaux sur des individus apparemment sains.
Quelles sont les limites de tels comportements ? Trop de prévention pourrait-il nuire à notre santé ? A quelles dérives l’excès de médicalisation nous expose-t-il ?
La médecine est une industrie comme les autres, avec ses objectifs de rentabilité, ses enjeux, ses stratégies marketing, ses mécaniques, à ceci près qu’elle génère des profits largement supérieurs à la plupart des autres industries. Tant et si bien qu’elle finit parfois par en oublier ce qui devrait être sa préoccupation principale, à savoir l’humain.
Ainsi, l’auteur souligne que le budget consacré au marketing représente souvent le double du budget consacré à la recherche et développement.
Il attire sans langue de bois notre attention sur les différents moyens déployés pour alimenter cette industrie. Il évoque notamment la manipulation de l’opinion publique par la surmédiatisation, la création de fausses revues spécialisées, le recours des firmes pharmaceutiques à des leaders d’opinion pour promouvoir les médicaments qu’elle produit auprès des médecins, ou encore la baisse des seuils de normalité qui fait inévitablement augmenter le nombre de malades potentiels - comme ce fut par exemple le cas avec le cholestérol ou encore l’hypertension artérielle qui a - de ce fait – vu son marché décupler en l’espace de trente ans.
Plus surprenant encore, il nous explique comment certaines maladies seraient créées pour satisfaire à la vente de nouveaux médicaments !
Des révélations plutôt inquiétantes mais nécessaires, qui nous invitent avant toute chose à la vigilance. Il ne s’agit pas de remettre en doute l’apport réel de la médecine et ses bénéfices incontestables, mais bien de nous inviter à ne pas transformer le souci d’une bonne santé en obsession, à ne pas pratiquer le recours systématique et immédiat à la prise de médicaments dès l’apparition du moindre trouble. A ne pas devenir un simple consommateur en somme.
Le docteur Boukris revendique un retour à une médecine plus humaine et individualisée, donnant la priorité à l’individu et non à la maladie, à la santé et non au profit.
Et se souvenir que, comme le disait si justement Alphonse Allaïs :
« Quels que soient les progrès de la médecine, la mortalité humaine sera toujours de 100%. » !
Mélina Hoffmann
Chronique publiée dans
le BSC NEWS MAGAZINE de Mars 2012